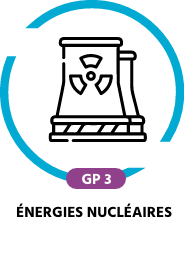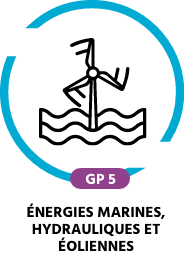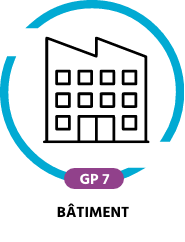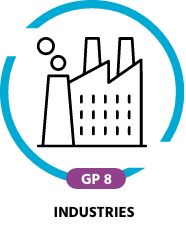Groupes
programmatiques
Accueil >
Au nombre de 10, ils sont, avec les groupes transverses, les organes fonctionnels de l’Alliance. Ils couvrent un périmètre et un champ disciplinaire précis et sont animés par des animateurs issus de membres fondateurs et associés et dûment mandatés par leurs entités de rattachement et le Président de l’Ancre.
Pour fonctionner et répondre aux différentes sollicitations et réflexions, ils s’appuient sur un vivier d’experts identifiés, également dûment mandatés par leur organisme d’origine. Ils peuvent, au besoin, associer des experts en provenance d’autres cercles (alliances, pôles de compétitivité, etc.) ou milieux (industriels, comité stratégiques de filières, etc.).
Les missions des groupes programmatiques sont les suivantes :
- Elaborer des réponses à des sollicitations des pouvoirs publics (MESR et MTE principalement), acceptées par le comité de coordination, en accompagnement des politiques publiques (SNBC, SNRE, PPE, Neutralité carbone, etc.).
- Participer à l’élaboration de la programmation de l’ANR et contribuer à l’élaboration des politiques et instruments européens dans le domaine de la recherche pour l’énergie.
- Conduire des réflexions propres au périmètre thématique couvert par le groupe programmatique, identifiées et retenues par le collectif des experts mobilisés
(benchmarks, feuilles de route, identification de défis, analyses de verrous, etc.).
- Conduire et /ou participer à des réflexions prospectives transverses entre groupes programmatiques ou avec d’autres alliances (Allenvi, Allistène et Athena en particulier), conduite sous la forme de projets.